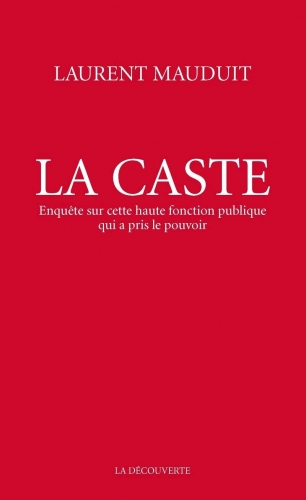Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de François-Bernard Huyghe, cueilli sur son site Huyghe.fr et consacré aux tentatives, grossières, du système politico-médiatique d'assimiler la vague populiste à une résurgence du fascisme... Spécialiste de la guerre de l'information, François Bernard Huyghe, auteur de nombreux livres, a récemment publié La désinformation - Les armes du faux (Armand Colin, 2015) et Fake news - La grande peur (VA Press, 2018).

Fascistométrie et rééducation des masses
Les années trente reviennent, paraît-il. Certes les esprits tatillons, très « vieux monde », pourraient trouver quelques différences mineures : une guerre mondiale encore fraîche avec ses millions de morts et ses anciens combattants au désespoir, une crise économique pré-keynésienne notamment dans une Allemagne ruinée et saisie par un chute folle de la monnaie, des revendications territoriales (ou des occupations) entre pays européens, le péril bolchévique qui terrifiait sur fond de grèves ou d’émeutes, des gens armés en chemise de couleur se battant partout, les puissances d’une Europe divisée reposant sur leur colonies, guère de concurrence économique d’Asie mais aussi guère d’État providence, réarmement partout, des migrations essentiellement inter-européennes, des sociétés encore largement chrétiennes et rurales, un nationalisme assumé par les classes dirigeante à rebours ce qu’elles professent aujourd’hui, des gouvernements très instables, la montée de partis politiques totalitaires s’assumant comme tels… Passons.
Chacun a bien compris qu’Emmanuel Macron jouait sur le point Godwin en nous suggérant un quasi retour du fascisme contre lequel il serait le dernier rempart. Fascisme est pour le moins un terme polysémique et nous nous sommes livrés à un petit test comparatif. En Italie puisque l’épouvantail Salvini est si souvent évoqué.
Prenons d’abord un définition « classique » par Umberto Eco qui, en 1995, énonce quatorze caractéristiques sinon de tous les fascismes, du moins du fascisme comme « ur-fascsimo », archétype (plutôt un schéma d’un fascisme absolu ou poussé à l’extrême, même si chaque fascisme particulier diverge légèrement par rapport à lui) :
- Culte de la tradition
- Refus du monde moderne
- Culte de l’action pour l’action
- Refus de l’esprit critique
- Culte de l’unité du peuple
- Appui sur les classes moyennes
- Obsession du complot
- Exaltation de la lutte contre un ennemi surpuissant
- Rejet de tout pacifisme comme trahison
- Élitisme de masse (notre communauté est supérieure)
- Culte du héros
- Machisme
- Droits des peuples contre droits des individus
- Recours à un néo-langage porteur de forts contenus idéologiques
Nous pourrions discuter chacun de ces points et nous demander plus en détail lesquels s’appliqueraient au stalinisme ou au maoïsme et lesquels seraient vraiment typiques de Salvini. Mais admettons qu’il s’agit d’un idéal-type, de tendances poussées à l’extrême et reconnaissons qu’Eco propose au moins des catégories significatives.
Petite comparaison avec un texte qui fait grand bruit en Italie vingt-trois ans plus tard L’Espresso publie en ligne un test intitulé « fascistometro » donc destiné à mesurer le degré de fascisme du lecteur suivant son nombre de réponses positives ou d’approbation à 56 affirmations. Ces affirmations que nous n’avons pas la place de reproduire ici peuvent apparaître comme de bon gros lieux communs, mais sont présentés par l’hebdomadaire centriste comme autant d’étapes sur le chemin qui nous mènerait aux années les plus sombres.
Quelques exemples :
- l’Italie est un pays ingouvernable
- Il nous faudrait un régime présidentiel
- Les journalistes sont tous au service du pouvoir
- Je vous rappelle que ces gens-là votent
- Il faudrait les recenser
- Je pense à nos garçons des forces armées
- C’est facile de parler quand on est bien au chaud
- Un pays sans frontière n’est pas un pays.
- Etc.
Le lecteur pourra consulter la liste complète, et, s’il le veut, procéder au test. On lui accordera que les phrases ne sont pas d’une immense finesse (cela dit : essayez d’inverser - un pays sans frontière est un pays, l’Italie est un pays gouvernable, je ne pense pas à nos garçons des forces armées, c’est courageux de parler quand on est bien au chaud- et faites vous des copains…) . Certes, nous ne cherchons pas à démontrer que les rédacteurs de l’Espresso (la romancière M. Murgia qui a rédigé le test) sont légèrement moins fins que l’auteur du « Nom de la rose ». Il y a une terrible différence de registre. Analyser le fascisme pour Eco, c’est penser quelques catégories fondamentales d’où découlent des attitudes. Pour L’Espresso c’est criminaliser des phrases de bistrot, avec une bonne dose de mépris de classe. C’est accessoirement culpabiliser des réactions populaires spontanées pour y dénoncer le germe de la nouvelle lèpre. Le fascisme le produit spontané de la niaiserie des masses : difficile de faire plus contre-productif.
Du reste, Mme Murgia publie en ce moment avec H. Janeczek intitulés « Attention au fascisme qui vit en vous ». L’idée est claire. Nous sommes tous potentiellement fascistes. Racismes et violences sont universels (ce serait donc une pulsion de nature et non une construction de quelques cultures dominantes ?). Il faut donc apprendre à s’autoanalyser et à s’autodiscipliner. Dressage et repentance. Le problème du fascisme n’est pas un problème politique, c’est un problème psychanalytique.Vigilance, camarades, dressons un barrage contre les pulsions des masses.
Proposition de test pour L’Espresso :
« Si vous étiez un fasciste désireux de gagner les prochaines élections que feriez vous aux électeurs ?
A) Je leur enverrais des gens en uniforme leur parler de dieux antiques, de mort au combat, de mobilisation totale du peuple tout entier, de la prochaine guerre à entreprendre contre un adversaire surpuissant...
B) Je leur ferais lire L’Espresso pour les persuader que ceux qui souhaiteraient plus d’emplois pour leurs concitoyens ou qui critiquent les fonctionnaires sont des nôtres : la preuve que le ventre est encore fécond d’où est sortie la bête immonde
C) je traduis le clip gouvernemental français (évoqué à l’article précédent)
D ) Je reprends les slogans psys de Mai 68 sur la libération de la parole et je crie « à bas le Surmoi ».François-Bernard Huyghe (Huyghe.fr, 3 novembre 2018)